 |
 |
 |
| Accueil | L'association | Historique | Recrutement | Contact | Liens |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Réhabiliter
la mémoire de tous les combattants de 1940
Nous nous intéressons aux Tirailleurs Algériens de 1940 car c'est un de ces régiments, le 18e, qui défend nos villages (Besmé, Blérancourt, Manicamp, Quierzy, St-Paul-aux-Bois, dans le département de l'Aisne) en mai-juin 1940. Le cas n'est pas rare, les unités venues d'Algérie sont en effet les plus nombreuses parmi les troupes venues d'outre-mer défendre la métropole. Ces unités de Tirailleurs Algériens sont constituées de français et d'algériens. On parle d'indigènes à l'époque. C'est pourtant un fait, la mémoire n'a pas toujours été à la hauteur de cet engagement. N'en déplaise à certains, la France a une histoire commune avec l'Algérie, entre 1830 et 1962. Notre Drapeau a flotté sur cette terre et des algériens ont défendu ce Drapeau. Rien ne justifie de passer sous silence ces réalités. Il ne s'agit pas pour autant de faire ici l'apologie ou le procès de cette époque à l'aune de notre période actuelle. L'empire colonial français fait partie du contexte de 1940. Il en est même une donnée essentielle. Un autre écueil est la dette pour les uns, créance pour autres, nées de cet engagement des algériens pour la France. On en fera jamais assez pour les uns, toujours trop pour les autres. Le pire serait de se taire. Malgré tous les drames, un regard apaisé doit être aujourd'hui porté sur cette période de notre histoire pour comprendre notre société.
 L’histoire
oubliée du 18e RTA, une
unité jetée au hasard en mai 1940 au
centre de la défense française sur
l'Ailette, entre
Somme et Aisne, qui défendit courageusement pendant 19 jours
nos
villages (Manicamp, Quierzy, Saint-Paul-aux-Bois, Besmé,
Blérancourt) avant de résister pied à
pied en
ordre jusque sur la Vienne et l'entrée en
vigueur de
l'armistice le 25 juin. Ce régiment, constitué d'algériens
et de français combattant côte à
côte,
décimé
sur l'Ailette, illustre la
résistance héroïque de
l’armée française
occultée
depuis et l'appoint
indispensable que constituent les troupes venues de l'espace
colonial français, Algérie en
tête, pareillement oublié. L’histoire
oubliée du 18e RTA, une
unité jetée au hasard en mai 1940 au
centre de la défense française sur
l'Ailette, entre
Somme et Aisne, qui défendit courageusement pendant 19 jours
nos
villages (Manicamp, Quierzy, Saint-Paul-aux-Bois, Besmé,
Blérancourt) avant de résister pied à
pied en
ordre jusque sur la Vienne et l'entrée en
vigueur de
l'armistice le 25 juin. Ce régiment, constitué d'algériens
et de français combattant côte à
côte,
décimé
sur l'Ailette, illustre la
résistance héroïque de
l’armée française
occultée
depuis et l'appoint
indispensable que constituent les troupes venues de l'espace
colonial français, Algérie en
tête, pareillement oublié.Force est pourtant de constater que, si 1940 est plus sérieusement étudié par les historiens depuis les années 1990, la participation des algériens reste un sujet tabou depuis l'indépendance de l'Algérie. Il n'existait pourtant avant 2010 aucun lieu de mémoire attaché à ces combats en dehors des cimetières militaires*. La
sortie du film "Indigènes" de Rachid Bouchareb en 2006 a
permis une prise de
conscience. Lire
"Autour du fim Indigènes"
(entretien avec Belkacem Recham, "Les musulmans
algériens
dans l’armée française 1919-1945,
Éditions
L’Harmattan, 1996).
"18e
RTA 1940" (Collectif
France
40 - Reconstitution) a
choisi la voie de l'histoire vivante
afin de donner la place qui leur est due aux
soldats français de 1940 et aux Tirailleurs en
particulier, à travers le 18e RTA de 1940. Nos objectifs
sont la
recherche historique (documents, objets, etc) en rapport avec cette
unité afin de contribuer à l'entretien
de sa mémoire en
participant notamment aux commémorations locales ou
nationales, mais aussi en maintenant le lien avec les anciens
Tirailleurs,
leurs familles, l'armée française.
Le groupe partage ainsi la vocation de tous ceux, qui comme l'association Déni de mémoire, veulent réhabiliter la mémoire de tous les combattants que l’histoire officielle a trop longtemps occulté. Le groupe illustre également à son tour la rupture avec la fascination malsaine pour l'armée allemande et le nazisme, qui a longtemps dominée en reconstitution l'intérêt pour cette période. Il partage la ligne suivie depuis 2006 par le magazine GBM notamment et rejoint certaines des conclusions du rapport de la Commission sur la modernisation des commémorations publiques présidée par l'historien André Kaspi en 2008. Le risque d'amalgame étant grand, la ligne du groupe n'est clairement pas la glorification de la période coloniale. Si les "indigènes" algériens et les français combattent côte à côte (dans les seuls régiments de Tirailleurs et de Spahis), leur situation respective est objectivement inégale à l'mage de l'Algérie française d'alors. Lire l'article Les « indigènes » dans l'armée française On relèvera aussi, chez Guy Pervillé toujours, des éléments sur la double difficulté à laquelle on se heurte concernant la mémoire 1) des combats de 1940 et 2) des Tirailleurs Algériens. Les combats de 1940 comme la guerre d'Algérie, longtemps considérés comme des "conflits honteux" ayant davantage contribués à la désunion des français qu'à leur rassemblement, sont de ce fait exclus de la politique mémorielle française. Lire De la glorification à la repentance .... __________ * Il existe dès 1950 un monument de la 7e DI à Leuilly-sous-Coucy.
Détestons la guerre, mais aimons ceux qui l’ont faite, pour ce qu’ils ont souffert «
Vous et moi nous détestons la guerre, mais nous aimons ceux
qui l’ont
faite, pour ce qu’ils ont souffert. »
Dédicace célèbre souvent reprise que
Roland Dorgelès adresse en 1964 à
Armand Lanoux sur un exemplaire de l’édition du
cinquantenaire de 1914des
Croix de Bois. Le lieutenant de réserve
Armand
Lanoux, rappelé
en septembre 1939 au 127e régiment d'infanterie, est fait
prisonnier
près de Rethel, sur les bords de l'Aisne, le 11 juin1940
dans des
conditions analogues à celles du lieutenant Soubeyrac de son roman Le
Commandant
Watrin, prix Interallié 1956.
Entretenir le
souvenir de l’Armée d’Afrique
C'est elle qui défend nos
villages en 1940, témoignant de l'appoint
indispensable que constituent les troupes venues de l'espace
colonial français, Algérie en
tête.
C'est d'elle que viendra à partir de 1942 la renaissance de nos armes et de la France. Sa diversité et sa fraternité d’armes illustrent les valeurs fondamentales de la République que défendent nos armées. Honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la République Honorer la mémoire de ceux
qui ont combattu pour défendre les valeurs de la
République, rendre hommage à toutes les victimes
des guerres mais aussi transmettre la mémoire des conflits
du XXe siècle aux jeunes générations,
tels sont les objectifs des cérémonies
commémoratives.
Les commémorations ont un sens, en tant qu’acteur du devoir de mémoire, notre rôle est :
*
Ces principes complètent ou précisent les valeurs exprimées par la devise de la République Française : « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Echapper à l'illusion rétrospective de la fatalité « Tout historien, pour
expliquer ce qui a été, se demande ce qui aurait
pu être » car « construire des
évolutions irréelles est le seul
moyen d'échapper à l'illusion
rétrospective de la fatalité ».
Raymond Aron, La philosophie de
l'histoire, p 164, repris par Antoine Prost, Douze
leçons sur l'histoire.
Les
historiens ont tendance à analyser une suite
d’événements à
la lumière de leur issue. Ante hoc, ergo propter hoc
(à la suite de, donc à cause de,
sophisme, paralogisme ou biais
cognitif consistant à prendre pour la
cause ce qui n'est qu'un antécédent
et prétendre que si
un événement suit un autre alors le premier est
la cause
du second !).
Des clés pour la mémoire Sources et références 1940 a immédiatement, suscité une énorme littérature, d’une qualité extrêmement variable mais, à de rares exceptions près1, ce n’est que depuis 1990, que les travaux de nature plus objective et scientifique se sont multipliés et dans une perspective exclusivement historique2. 1 Cf. par exemple : Marc Bloch, L’étrange défaite, Colonel Alphonse Goutard 1940, La Guerre des occasions perdues, 1956 (publié la même année que Soixante jours qui ébranlèrent l’Occident (10 mai-10 juillet 1940) de Jacques Benoist-Méchin, fidèle pétainiste). 2 Cf. notamment par ordre chronologique : Pierre Rocolle, La défaite de 1940. 1 : Les illusions (novembre 1918-mai 1940). 2 : La défaite (10 mai-25 juin), Paris, Armand Colin, 1990, 2 vol. ; Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Les Français de l’an 40, Paris, Gallimard, 1990, 2 vol. ; Patrick Facon, L’Armée de l’air dans la tourmente. La bataille de France (1939-1940), Paris, Economica, 1997 ; Gérard Saint-Martin, L’arme blindée française. 1 : Mai-juin 1940 : les blindés français dans la tourmente, Paris, Economica, 1999 ; Bruno Chaix, Fallait-il entrer en Belgique ? Décisions stratégiques et plans opérationnels de la campagne de France, Paris, Economica, 2000 ; Christine Levisse-Touzé (dir.), La campagne de 1940, Paris, Tallandier, 2001 ... Lire Philippe Garraud
- L’idéologie
de la « défensive » et ses effets
stratégiques
La diagonale de la
défaite, de Jean-Philippe Immarigeon, 2010
La Diagonale de la Défaite est un livre anti-clichés sur la campagne de 1940. Un livre qui surprend par ses points de vue et ses analyses, l’antithèse de L'impardonnable défaite, de Claude Quétel. Lumineusement explicatifs de la campagne de 1940, Immarigeon livre un ouvrage salutaire, érudit et pertinent sur la campagne de 1940 avec des passages prodigieusement intéressants et une perspective par instants révolutionnaire. Un livre à recommander pour tous ceux qui veulent prendre du recul sur le sujet, sortir des arguments émotionnels ou des redites historiographiques autour d'une supposée décadence politique et militaire de la France. La non-appartenance de l’auteur au cercle des historiens permet une vision iconoclaste de la défaite de 1940. L’auteur fait du contre-pied un art majeur. Le lecteur, habitué à lire des analyses politico-sociales courtes-pattes sur la bêtise du monde politique d’avant-guerre et des généraux benêts, apprend qu’on peut voir dans la défaite de 1940 d’autres causes que celles ressassées par Vichy et reprises à l’emporte-pièce depuis 70 ans en se concentrant sur les thèmes militaires et industriels qui paraissent expliquer suffisamment la défaite de 1940. La doctrine de l’armée française est alors considérée comme un modèle et copiée dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis, qui s’en inspirent, notamment avec le concept novateur de la « bataille conduite » de Foch.
Le chapitre concernant les chars rappelle qu’avant 1940, l’arme blindée n’avait pas fait ses preuves. La puissance de l’arme blindée dans la Seconde guerre mondiale, est mise en avant rétrospectivement à la lumière des événements de mai-juin 1940. Pendant le premier conflit mondial, l’arme blindée n’eut pas l’effet décisif qu’on lui prête, c’est Ludendorff, grand inspirateur d’Hitler, qui le premier évoqua « une masse de chars irrésistible » dès 1918 afin de donner des raisons à la défaite allemande de novembre 1918. Le grand conflit de l’immédiat avant-guerre, la guerre d’Espagne, n’avait pas du tout démontré une domination de l’arme blindée, le rôle de l’aviation était alors apparu bien plus éclatant. Ceci n’avait pas empêché la France, comme l’Angleterre, l’URSS ou les Etats-Unis de développer une arme blindée, avec des technologies bien supérieures aux allemands (les armements de ses derniers ne reprenant le dessus qu’à la fin 1942). Surtout, l’auteur démontre que les doctrines d’emploi étaient similaires d’un camp à l’autre. Ce n'est que quelques mois avant le choc de mai 1940 que quelques officiers isolés ont, en Allemagne, développé une tactique tout à fait opportuniste, appelée à devenir une doctrine à part entière a posteriori. Autre point intéressant, l’auteur décrit l’effort industriel significatif de la France dans le domaine militaire, un aspect généralement minoré, sinon carrément occulté, avec force détails sur les réussites nationales dans cette matière. Évidemment, si cet effort était bien lancé, quoi qu'en disent les tenants de la "déchéance nationale", il lui fallait encore du temps pour atteindre un niveau suffisant. Chez Immarigeon, point de décadence des élites et encore moins de théories complotistes pour expliquer la défaite de 1940. Le personnel politique et les militaires européens, pas seulement français, ont été dépassés par la vision « barbare » de la politique, de la diplomatie et de la guerre portée par les nazis. Ajoutons une pincée de hasards, de coups de malchance bref de ces aléas dont notre monde moderne ne veut plus entendre parler, par volonté de contrôle maximum, et voilà la catastrophe de mai-juin 1940. Bien sûr, résumée ainsi, la thèse pourra paraître assez simpliste, et on peut parfaitement ne pas être d’accord avec l’auteur. Mais le raisonnement se tient, d’autant qu’il est argumenté de manière solide. La note-programme
de Weygand du 28 juin 1940
Dès le comité de guerre du 25 mai 1940, Weygand condamne l’entrée en guerre de la France et déclare : « Mais on ne doit penser qu’au relèvement du pays, et le courage avec lequel elle se sera défendue sera un élément décisif du redressement futur ». Le 28 juin 1940, trois jours après l'entrée en vigueur de l'armistice, Weygand, commandant en chef de l'armée française depuis le 19 mai et ministre de la guerre de Pétain depuis le 17 juin 1940, rédige avec le chef du gouvernement, qui est encore à Bordeaux, une étonnante note destinée à la presse, véritable programme de la « révolution nationale » : corporatiste, cléricale, xénophobe et antisémite. « L'ancien ordre des choses, c'est-à-dire un régime de compromissions maçonniques, capitalistes et internationales, nous a conduit où nous sommes. La France n'en veut plus ... » ... « Aujourd'hui, c'est une équipe composée d'un petit nombre d'hommes nouveaux sans tâches, ni attaches, animés de la seule volonté de servir qui soit, sous le direction du maréchal Pétain, chef reconnu de tous, proclamer son programme et se mettre à l'oeuvre. » On y relève notamment que la baisse de la natalité a amenée « du point de vue militaire, à défendre notre territoire avec une proportion inadmissible de contingents nord-africains, coloniaux et étrangers » ! On se souvient de son refus à la mi-juin de replier l'armée, puis le gouvernement et le parlement vers l'Afrique du Nord, afin d’y poursuivre la lutte aux côtés du Royaume-Uni. Weygand sera nommé en septembre 1940 délégué général pour l'Afrique du Nord ... Il sera après-guerre le défenseur de la mémoire de Pétain. Le
choix de la défaite : Les élites
françaises dans les années 1930,
Annie Lacroix-Riz
Quelles sont les causes de la défaite de 1940 ? Le grand historien Marc Bloch écrivait en avril 1944 : " Le jour viendra [...] et peut-être bientôt où il sera possible de faire la lumière sur les intrigues menées chez nous de 1933 à 1939 en faveur de l'Axe Rome-Berlin pour lui livrer la domination de l'Europe en détruisant de nos propres mains tout l'édifice de nos alliances et de nos amitiés. " Annie Lacroiz-Riz analyse l'histoire des années 1930 pour éclairer les causes de la défaite de 1940. Selon elle, les Français n'ont pas été simplement été vaincus en cinq jours par une Wehrmacht invincible ; le haut patronat les a sacrifiés à son plan de " réforme de l'Etat " copié sur les voisins fascistes et à son obsession d'accord avec le Reich. Cette affirmation incroyable paraît moins audacieuse à la lecture des archives, françaises et étrangères, relatives à une décennie d'actions des élites : militaires ; politiciens ; journalistes ; hommes d'affaires surtout, qui régnaient sur tous les autres, avec à leur tête la Banque de France et le Comité des Forges. L'autonomie des politiciens ou des journalistes relève ainsi du mythe, celle des militaires aussi. C'est bien la France des grands intérêts économiques et financiers qui dicta le choix de l'Allemagne comme partenaire privilégié dès les années 1920 et sabota l'alliance russe de revers qui avait évité la défaite en 1914. Aujourd'hui, l'accès aux archives éclaire les causes intérieures et extérieures de la Défaite et permet " l'instruction du procès de la vaste entreprise de trahison " que réclamait Marc Bloch. |
|||||||||||||||||||
|
Sur plus de 200 000 militaires français, FFI inclus, morts au champ d’honneur au cours du second conflit mondial, près de 100 000 sont systématiquement absents des hommages nationaux : les soldats tombés en mai-juin 1940 au cours de la campagne de France, bien qu'en proportion de la durée des combats ils soient plus nombreux que leurs ainés de 14-18. 70 ans après, le soldat français de 1940 reste la victime expiatoire d'un tabou qui continue de peser sur notre cohésion nationale et notre confiance en nous. La défaite de 1940, période sombre de notre histoire reste pour beaucoup bien plus qu'une défaite militaire. 1940 ; ce serait l'effondrement moral impardonnable d'un peuple tout entier « l’esprit de jouissance l’ayant emporté sur l’esprit de sacrifice ». Cette vision simpliste du déclin de la France, livrée dès le 25 juin 1940, est aujourd'hui contredite par les historiens français et étrangers, qui se penchent depuis peu sur cette campagne de 1940 avec un nouveau regard. 70 ans après, l’ignorance ou l'oubli ne sont plus de mise. Il est temps de rétablir la vérité sur « les mensonges qui nous ont fait tant de mal ». Cette interprétation n’est autre que l’écho persistant de la propagande de Vichy. Pour Pétain*, la défaite ne peut être celle de ses stratèges, ceux qu’il a cautionnés durant toute l'entre deux guerre, période à laquelle, contrairement à sa légende, il occupe les plus hautes fonctions militaires. La défaite de 1940 est bien en premier lieu une défaite militaire, celle des grands chefs de notre armée et non la défaite morale de tout un peuple, soldats compris, théorie montée de toute pièce pour justifier la « Révolution Nationale » et appliquer le programme politique qu’une extrême droite minoritaire n’a jamais pu s’imposer par les urnes. Le printemps 1940 fut tout d'abord une défaite de la pensée militaire puis de la volonté de ses dirigeants. L'exemple de la bataille du Nord est saisissant à cet effet. La manœuvre Dyle-Breda, erreur monumentale de l'état-major allié, après tant d'autres, s'achève par le sacrifice des armées françaises permettant le rembarquement de l'armée britannique. « Sans Dunkerque, il n'y aurait pas eu de 6 juin 1944 » dira le Prince Charles d'Angleterre en 2000. En ce mois de juin 1940, « l’esprit de sacrifice » est en effet bien là. Près de 100 000 soldats français tués en quelques semaines de combats, c’est plus en proportion que les pertes des pires batailles de 14-18 ou celles des allemands sur le front de l’Est en 1941. Mai-juin 1940, c'est le village de Stonne, Rethel pris et repris 10 fois, l’Aisne où la division de Lattre invaincue fait 2.000 prisonniers, les régiments entiers sacrifiés sur place dans les Ardennes, sur la Somme, les ouvrages de la ligne Maginot qui résistent encore après l’armistice, l’armée des Alpes invaincue face aux Italiens épaulés par les allemands, la liste est longue. On est bien loin de la burlesque 7e compagnie, hélas symbolique pour beaucoup de français de l’attitude de leur armée pendant la campagne de 40. Difficile cependant pour les responsables militaires ou civils de 1940 d'avouer, exemple parmi d'autres, que la majorité des prisonniers français ont été capturés après le malheureux appel à « cesser le combat » lancé le 17 juin ... avant même les premiers pourparlers d’armistice. « On » a ainsi envoyé des centaines de milliers d’hommes à la mort ou en Allemagne. Même un vieux maréchal de 14-18 ne saurait échapper à la lourde responsabilité qui est la sienne d'avoir soutenu et incarné une politique désastreuse dès le premier jours de sa prise de fonction, en livrant sa propre armée et son pays à un ennemi à bout de souffle à la mi-juin 1940, ce que nul ne pouvait ignorer en haut lieu. Ayant subi de lourdes pertes en homme et en matériel, désormais très éloignés de leurs bases, les allemands n'en espéraient pas tant et en seront reconnaissants. Dès 1949 pourtant dans ses Mémoires, Churchill explique que l'armistice de juin 1940 n'était en rien inéluctable, ce que les historiens confirmeront par la suite : « Le gouvernement français se serait replié en Afrique du Nord. [...] Les flottes françaises et britanniques auraient bénéficié, depuis leurs ports, d'une complète maîtrise de la Méditerranée et de la liberté totale de passage pour les troupes et leur ravitaillement. [...] La France n'aurait jamais cessé d'être l'une des principales puissances alliées en lutte, et aurait donc été épargnée par la terrible déchirure qui a divisée et divise encore son peuple. » Mais pendant des décennies, dans leurs "mémoires", les responsables politiques français ont tenté de minimiser leur responsabilité en mettant en avant « l'incompétence de l'armée » et les généraux, comme Gamelin, en fustigeant « la défaillance des soldats ». Longtemps, ces théories infondées n'ont pas été sérieusement remises en cause par nombre d' « historiens » complaisants et surtout pas au sommet de l'état, sous prétexte de préserver la cohésion nationale ... sans pour autant omettre d'aller fleurir jusq'en 1992 la tombe du maréchal de 14-18. Les combattants de 1940 attendent donc toujours le discours d'un Président de la République (à l'occasion du 18 juin ?) rappelant, leur sacrifice « à l’avant-garde de la liberté » comme le soulignait le général de Gaulle aux alliés. Il récidivera à Bruneval le 30 mars 1947 : « En vérité la Résistance française, c'était la Défense Nationale, elle a commencé le 3 septembre 1939 ». Le propos n'est pas nouveau : La Résistance a commencé le 3 septembre 1939, Col. Rémy, 1979. Car en dépit de réelles déficiences, il serait plus exact de dire que l’Allemagne avait une guerre d’avance plutôt que la France une guerre de retard. L’emploi de nos forces fut certes inadapté à la guerre nouvelle conduite par l'ennemi, l'historien Marc Bloch le notait dès 1940. Cependant, aucune grande puissance militaire n'avait en 1940 la conception d’emploi des blindés et de l’aviation des allemands. Et contrairement à la France, en première ligne avec à peine 300 km de « profondeur stratégique » avant Paris, ce n'est que grâce aux remparts constitués par la Manche, l’Atlantique ou l’immensité de son territoire que la Grande-Bretagne, l'Amérique ou la Russie ont pu avoir le temps de construire les chars et les avions de la victoire et surtout d'apprendre à s'en servir. Au-delà de la vérité historique, l’enjeu est de laver le doute qui plane toujours sur tout un peuple et un pays qui doute de son passé ne peut affronter l’avenir et ses défis avec toutes les chances de succès.
100 000 morts oubliés, Jean Pierre Richardot Les Allemands ont eu par jour plus de 2 000 soldats mis hors de combat, dont une moitié de tués. Nos pères et grands-pères se sont aussi bien battus que les Américains quatre ans plus tard à Omaha Beach. En 1940, nos soldats voulaient poursuivre les hostilités. Jamais le peuple français n'a appelé Pétain au pouvoir. C'est un coup d'État, avec faux et usage de faux, qui a permis aux généraux français antirépublicains de livrer nos soldats à l'ennemi, de les menacer du conseil de guerre s'ils continuaient à se battre. Ce sont nos généraux, parfaitement incompétents et dépassés, qui ont rompu avec l'Angleterre et placé notre pays sous la tutelle nazie. 100 000 morts oubliés, la bataille de France 10 mai - 25 juin 1940, Jean-Pierre Richardot, collection Document, Le cherche midi, 2009
« L'Afrique du Nord est en mesure de résister longtemps aux entreprises de l'ennemi. » L'idée
de «
refuser
de
la défaite » et
de «
poursuivre
le combat contre l'ennemi » n'est pas née
à Londres le 18 juin 1940. Dès
le 25 mai 1940, lorsque
Weygand renonce à toute nouvelle
manoeuvre et présente son projet d'ultime bataille
défensive sur la Somme et l'Aisne, divers projets
de bataille de
retardement en vue d'un embarquement des
forces encore sur pied vers l'Afrique du Nord et l'Angleterre voient le
jour.
Le 26 mai, le général Prétélat, commandant le groupe d'armée qui tenait la ligne Maginot, propose à Weygand d'en ordonner le repli sur le Morvan et le Jura : Weygand n'y consentira que le 12 juin ! Le 27 mai, le général Bührer, chef d'état-major des troupes coloniales, prévient Georges Mandel des « dangers de la ligne continue » de Weygand. et propose de « procéder à des replis profonds, de manœuvrer en retraite en s'appuyant sur deux môles de résistance solides, à constituer dans le Jura avec les armées de l'Est qu'il ne fallait à aucun prix maintenir sur la ligne Maginot puisqu'elle était déjà tournée au Nord, et en Bretagne avec des éléments franco-britanniques». Le général de Gaulle, de son côté, avait suggéré à Weygand de répartir les quelque 1 200 chars restant disponibles en les renforçant chacun de deux ou trois divisions d'infanterie et d'une unité d'artillerie, l'une au Nord de Paris, l'autre au Sud de Reims, « pour agir, lui écrivit-il, dans le flanc des corps blindés allemands quand, poussant sur leur direction de marche après rupture de notre front, ils se trouveraient plus ou moins disloqués en largeur et étirés en profondeur ». Les généraux Besson, du Groupe d'Armées n°3, et Frère, de la 7e Armée, objectent également que la résistance sur place de leurs unités va aboutir à leur anéantissement rapide au regard du rapport des forces. Au soir du 17 juin, le général Besson, prendra soin de dissiper les effets calamiteux du discours de la mi-journée du nouveau Président du Conseil appelant à cesser le combat : " Il n'y a ni armistice, ni suspension des d'armes. La bataille continue. " Jusqu'au bout, tout justifiait la position prise par le général Noguès, commandant en chef des forces françaises d’Afrique Française du Nord, contre l'armistice et jusqu'à ce que celui-ci fut signé, qu'il développait dans son message envoyé au gouvernement de Bordeaux, le 23 juin : « L'Afrique du Nord, avec ses ressources actuelles, les renforcements d'aviation en cours, qui ont une importance capitale, et avec l'appui de la flotte, est en mesure de résister longtemps aux entreprises de l'ennemi. » Voir également La France continue
la guerre
Poursuivre la
guerre : un choix rationnel
Dès le 25 mai 1940, lorsque
Weygand renonce à toute nouvelle
manoeuvre et présente son projet de bataille
défensive sur la Somme où toutes les forces
disponibles seraient engagées, ce qui voulait dire,
dans l'hypothèse de la défaite qu'il
prévoyait, qu'il n'envisageait aucune autre
opération d'envergure, que ce fut une bataille de
retardement ou, à plus forte raison, un embarquement des
forces encore sur pied vers l'Afrique du Nord et l'Angleterre, on
peut penser qu'à travers sa stratégie se
profilait déjà la capitulation qu'il avait
choisie.
Plusieurs chefs militaires français l'avaient bien compris et critiquèrent les décisions prises par Weygand. Le 27 mai, le général Bührer, chef d'état-major des troupes coloniales, prévient Georges Mandel des « dangers de la ligne continue » que s'efforçait d'établir le commandant en chef. L'ennemi, annonçait-il, percerait aisément ce faible cordon et nos éléments dissociés seraient enfermés sans arrêter sensiblement la marche de l'ennemi. Dans une perspective évidemment différente de celle de Weygand, il proposa de « procéder à des replis profonds, de manœuvrer en retraite en s'appuyant sur deux môles de résistance solides, à constituer dans le Jura avec les armées de l'Est qu'il ne fallait à aucun prix maintenir sur la ligne Maginot puisqu'elle était déjà tournée au Nord, et en Bretagne avec des éléments franco-britanniques ». Dans le même esprit, et sans doute dans le même but, le général Prétélat, commandant le groupe d'armée qui tenait la ligne Maginot, avait proposé à Weygand, la veille, 26 mai, d'en ordonner le repli sur le Morvan et le Jura : Weygand n'y consentit que le 12 juin alors qu'à cette date les blindés de Guderian se dirigeaient déjà vers Langres qu'ils atteignirent le 15 avant d'arriver à Besançon et Pontarlier le 17, devançant inévitablement les mouvements du groupe d'armées qui tenait la ligne Maginot, constitué en grande partie de troupes de forteresse et qui ne purent ainsi échapper à l'encerclement. Le général de Gaulle, de son côté, avait suggéré à Weygand de répartir les quelque 1 200 chars restant disponibles en les renforçant chacun de deux ou trois divisions d'infanterie et d'une unité d'artillerie, l'une au Nord de Paris, l'autre au Sud de Reims, « pour agir, lui écrivit-il, dans le flanc des corps blindés allemands quand, poussant sur leur direction de marche après rupture de notre front, ils se trouveraient plus ou moins disloqués en largeur et étirés en profondeur ». Les décisions à prendre après l'encerclement des armées du Nord et de Belgique impliquaient déjà les choix à venir. En engageant toutes ses forces dans une confrontation qui ne serait que de quelques jours, Weygand avait implicitement choisi la capitulation à court terme. Comme on ne pouvait alors douter que le territoire français allait être irrémédiablement envahi par l'ennemi, poursuivre la guerre supposait évidemment d'autres décisions. En pratique, il fallait retarder le plus possible l'avance allemande pour regrouper les forces que l'on pourrait transférer en Afrique du Nord ou en Angleterre. Dans cette perspective, les propositions du général Bührer étaient les plus logiques et, de toute façon, la poursuite de la guerre aurait impliqué, non une impossible bataille d'arrêt, mais des manœuvres de retardement délibérément menées en vue de pouvoir continuer la lutte au-delà des mers : « Il y aurait eu combat, devait écrire le général de Gaulle, au lieu d'une débâcle. » Les généraux Besson, du Groupe d'Armées n°3, et Frère, de la 7e Armée, objectent également que la résistance sur place de leurs unités va aboutir à leur anéantissement rapide au regard du rapport des forces en présence et demande l'organisation d'une deuxième position défensive à 50 kilomètres au sud de la Somme sur une ligne Soissons, Compiègne, Clermont, Beauvais, Gournay et la Vallée de la Béthune. Le 30 mai, Weygand refuse ; nos effectifs sont à peine suffisants sur la Somme et l'Aisne. Besson passe outre ; seule une manoeuvre en retraite sur une grande profondeur nous permettra de nous ressaisir tout en affaiblissant l'ennemi. Jusqu'au bout, tout justifiait la position prise par le général Noguès, commandant en chef des forces françaises d’Afrique Française du Nord, contre l'armistice et jusqu'à ce que celui-ci fut signé, qu'il développait dans son message envoyé au gouvernement de Bordeaux, le 23 juin : « L'Afrique du Nord, avec ses ressources actuelles, les renforcements d'aviation en cours, qui ont une importance capitale, et avec l'appui de la flotte, est en mesure de résister longtemps aux entreprises de l'ennemi. » Voir également La France continue la guerre Gilles Ragache, La fin de la campagne de France : Les combats oubliés des armées du centre, 15 juin - 25 juin 1940 1940, La Guerre Des Occasions Perdues, A. Goutard Alphonse
Goutard,
combattant de l'Armée d'Afrique, armée
qui « avait gardé
l'orgueil d'une armée qui n'a pas été
vaincue ».
Le colonel A. Goutard publiait 1940, La Guerre Des Occasions Perdues, avec une préface de de Gaulle, au moment même où paraissaient les Soixante Jours Qui Ebranlèrent l'Occident de J. Benoist-Méchin, pétainiste fidèle. Les conceptions de Goutard rejoignent les idées développées par Karl-Heinz Frieser, par le général Koeltz etc. Bien avant que les historiens aient accès aux archives, Marc Bloch (L'Étrange Défaite, 1946) et Alhonse Goutard (1940, La Guerre Des Occasions Perdues, 1956), tous deux combattants de 1940 mais aussi historiens, contredisent les thèses alors largement répandues depuis 1940. Bloch est le premier historien à constater les responsabilités du commandement dans la défaite. Il dénonce la mauvaise organisation de l’armée pour la gestion des hommes et du matériel, la transmission des ordres… Pour Goutard, l’origine de la défaite est avant tout à chercher dans une doctrine « périmée », un plan de campagne « erroné », un dispositif général « défectueux ». Tout au long de son ouvrage, il affirme encore que l’armée n’a pas fui, que la Werhmarcht pouvait être vaincue et que la responsabilité d’un haut commandement vieillissant est complète. Pourquoi 1940 ? Pourquoi cet effondrement qui a annulé une victoire qui nous avait coûté tant de sang, le sang de quinze cent mille morts tombés en vain, puisque, quelque vingt ans après leur sacrifice, la France a été entièrement envahie et sou mise au joug des Barbares nazis? Le Pays a le droit de savoir la vérité sur cette défaite unique en son histoire. Or, ce drame, il ne le connaît pas ! Il n'a vu que la face hideuse de la débâcle, et on lui a expliqué que ce désastre était fatal, logique, inévitable, et que personne n'en était respon sable, sinon le Pays tout entier. Sur cette lamentable campagne de 1940, nous n'avons guère, en effet, que les mémoires des généraux battus: généralissimes successifs, chef d'état-major du front Nord-Est, major général, commandants d'armée, de corps d'armée ou généraux de moindre envergure. Comment ces chefs, qui n'ont su ni prévoir la guerre-éclair à base de blindés et d'aviation, ni la préparer, ni s'y adap ter, pourraient-ils maintenant s'élever au-dessus de leur défaite et en reconnaître les causes? Leurs ouvrages ne sont donc, en général, que des plaidoyers pro domo, encore que souvent ils constituent d'involontaires autocritiques! Mais, a-t-on dit, notre défaite n'est pas une défaite militaire, et les chefs de notre Armée ne sauraient en être tenus pour res ponsables. On lui a donc trouvé, de préférence, des raisons méta physiques. On a vu en elle une sorte de punition céleste. «Elle est venue, a déclaré ... Pétain dans son message du 25 juin 1940, de notre relâchement et de notre esprit de jouis sance». Sans doute y a-t-il là une part de vérité; mais ce n'est pas «l'esprit de jouissance» de la Nation qui a forcé notre com mandement à conserver une doctrine périmée, à arrêter un plan de campagne erroné, à adopter un dispositif général défectueux, et enfin à se laisser constamment manœuvrer par l'ennemi, sans tenter la moindre réaction sérieuse, alors que s'offraient des occa sions de victoire! Pour excuser notre défaite, on a dit également que nous avions été écrasés sous le nombre des combattants et sous le poids d'un matériel considérablement supérieur au nôtre, si bien que, comme l'a encore proclamé ... Pétain, «quand la bataille s'est engagée, nous ne pouvions plus opposer à cette supériorité que des mots d'encouragement et d'espoir». Mais que savons-nous de cette Armée ennemie? Une des caractéristiques les plus curieuses des mémoires de nos généraux et des relations des historiens officiels ou conformistes est l'igno rance dans laquelle ils nous laissent de la situation réelle, maté rielle et morale, de l'Armée allemande de 1939 et de 1940. Comme elle nous a vaincus, ils nous la présentent comme un instrument formidable et irrésistible. Dans toutes les guerres, il y a un certain nombre de clichés, établis d'après les impressions du moment et qui fournissent une explication facile des événements, tout en ménageant l'amour-propre du pays et de ses grands chefs militaires. Mais avec le recul du temps, et lorsqu'il devient possible d'étudier ce qui se passait « de l'autre côté de la colline », où la situation était souvent bien différente de celle que l'on imaginait, on se rend compte de la fausseté de ces jugements hâtifs que l'on croyait définitifs. Nous verrons ainsi ce qu'il en était réellement de la toute-puissance de l'Armée allemande entrée en guerre en 1939, de son moral inébranlable, de sa préparation très poussée, de la valeur irrésistible de sa Luftwaffe et de ses Panzer, de la solidité de sa Ligne Siegfried et du rendement extraordinaire de son industrie de guerre! En parlant du « bluff » de la Wehrmacht pendant toute cette période de 1936 à 1940, nous choquerons certainement ceux qui, ayant gardé la terreur des Stukas et des Panzer, se fient aux clichés établis. Mais les faits et les chiffres sont là, de même que les témoignages unanimes des généraux allemands. Parce que Hitler a gagné la partie de poker, cela ne signifie pas qu'il avait tous les atouts en main! Nous en avions .également, et qui valaient à peu près les siens, mais il eût fallu savoir nous en servir et les jeter résolument dans le jeu. Impressionnés par un bluff qui durait depuis 1936, peu confiants en leur Armée, qu'ils n'avaient pas su forger pour la lutte, peu confiants surtout en eux-mêmes, se sentant dépassés dans leur conservatisme étroit, mais se cramponnant quand même à leur doctrine et à leurs procédés hérités de la guerre de 1914-1918, nos grands chefs étaient voués à la peur d'agir et à la passi vité la plus absolue. Au premier choc d'une tactique nouvelle et d'un rythme inattendu, si différent de celui de la première guerre mondiale, ils ne pouvaient donc que s'abandonner à une «Fatalité» qu'ils croyaient inéluctable et à un «Destin» qu'ils considéraient comme scellé! Et le pays lui-même, trompé par ses augures, a trouvé la défaite toute naturelle ! Il est temps, ne serait-ce qu'à titre de leçon pour l'avenir, de réviser ces jugements simplistes et avantageux. ... Il semble donc bien que notre défaite puisse être imputée essentiellement à une carence intellectuelle qui se traduisait par le conservatisme, le conformisme, les idées préconçues et les spéculations hors du réel, bref à une colossale erreur de commandement, rendue irrémédiable par le manque de ressort de l'époque, bien plus qu'à une impuissance foncière de notre Armée et du Pays dont elle émane.Les évolutions historiographiques de la débâcle de mai-juin 40 depuis 1945 A
propos du mémoire d'Aliston
Braillon sous la direction du Professeur Santamaria
de l’Université Pierre
Mendès-France de Grenoble
Ce mémoire distingue une phase pétainiste, une phase gaulliste, les travaux des militaires français, les études des anglo-saxons, la vision allemande de la défaite française et débouche sur l'idée d’une « étrange victoire allemande ». I - Mai-Juin 40 par les pétainistes Pétain dans son discours radiophonique du 20 juin 1940 par lequel il annonce la demande d’armistice qu’il a formulée, résume les causes de la défaite « trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop peu d’alliés ». Au fil des mois et des ans, « l’Etat français » fait le procès de la IIIème République, de la démocratie, des réformes sociales du Front populaire. Pourtant la responsabilité de Pétain est écrasante. C’est lui qui a inspiré la politique militaire de la France de 1920 à 1940 : commandant en chef des Armées en 1920, Ministre de la Guerre en 1934, membre du Comité Permanent de la Défense Nationale, du Conseil Supérieur de la Guerre et du Conseil Supérieur de la Défense Nationale. « Trop peu d’enfants » La France compte 42 millions d’habitants contre 80 en Allemagne. La France alignera certes autant de divisions que l’Allemagne, mais c’est un pays de « vieux », y compris parmi les chefs militaires. « Trop peu d’armes » Pour l’armement classique l’armée française est aussi bien dotée que la Wehrmacht (fusils, mitrailleuses, artillerie, DCA) le nombre de chars est équivalent mais leur utilisation est radicalement différente dans les deux armées : les Allemands ont des divisions blindées, les Français ont éparpillé leurs chars en appui à l’infanterie, comme en 1918. En 1935, Le Président du Conseil Paul Raynaud, influencé par le Colonel de Gaulle, avait préconisé la formation de divisions blindées, ce qui avait été refusé. L’aviation française reste inférieure en nombre et en qualité à la Luftwaffe malgré le réarmement massif entrepris depuis 1938. Il faut ajouter aussi que les avions les plus performants n’ont pas été engagés dans la bataille. Ils étaient en réserve à l’arrière ! « Trop peu d’alliés » Avant la première guerre mondiale la France avait la Russie et le Royaume Uni comme alliés. L’URSS avait conclu le pacte germano-soviétique en 1939. Les hommes politiques français étaient très méfiants à l’égard du communisme et par là, ont favorisé l’alliance (temporaire !) des nazis et des soviétiques. Le Royaume Uni après des années de politique « d’appeasement » a finalement choisi son camp, mais en mai 1940 il n’a envoyé que 10 divisions sur le front. Par cette vision simpliste de la débâcle, Pétain veut se dédouaner et dégager la responsabilité des chefs militaires. Le procès de Riom va apporter un démenti cinglant. Le Procès de Riom Il s’ouvre le 19 février 1942. Pétain et son gouvernement voulaient démontrer l’irresponsabilité de la IIIème République. Comparaissent devant le tribunal : le général Gamelin, Edouard Daladier, Léon Blum, Guy Le Chambre (ancien ministre de l’Air), Jacomet (contrôleur général). On les accuse tout simplement d’être les responsables de la défaite ! Rapidement, les arguments de la défense balaient ceux de l’accusation. Pétain suspend le procès le 14 mars 1942 et impose le verdict, les accusés sont condamnés à la détention à perpétuité, livrés à la police allemande et déportés. II - Mai-Juin 1940 par les Résistants En 1947, une commission d’enquête parlementaire est chargée d’enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945. Elle efface les liens entre l’avènement du Front Populaire en 1936 et la défaite. Elle insiste par contre sur l’incohérence des ordres donnés par la hiérarchie militaire. Les reculades françaises à partir de l’avènement d’Hitler en 1933 sont soulignées : réarmement de la Rhénanie, rétablissement du service militaire, l’Anchluss, Munich. Tous ces coups de force ne provoquent aucune réaction. La France a eu tort de suivre la politique anglaise d’« apeasement ». Chamberlin s’est aperçu un peu tard qu’Hitler n’était pas « un gentleman ». Les historiens insistent sur l’influence de pro fascistes, notamment des intellectuels, De Brinon, Bonnard, Brasillac, Drieu la Rochelle, Céline … Pendant cette période, on continue de mettre en exergue les débandades et lâchetés des combattants de 40, ce qui ne sera pas sans provoquer des réactions chez ceux qui ont vécu le drame. L’armée nazie est glorifiée : son armement aurait été très supérieur, ses chefs, jeunes et dynamiques ont réalisé « la guerre éclair ». Bref, rien de bien neuf. La vision accablante de cette période n’est pas remise en question. Pour les gaullistes seule la Résistance compte et l’on occulte la période précédent le conflit mondial. Quant aux communistes, le pacte germano-soviétique les met mal à l’aise et il y a de quoi ! Donc oublions cette période et exaltons la résistance à partir de 1941 ! quand l’URSS aura été envahie par les nazis. III - Mai Juin 40 par les militaires Marc Bloch et le colonel Goutard étaient des combattants mais aussi des historiens. Dès 1940, ils nous font part de leur vécu et contredisent les thèses alors fort répandues. Bloch est en effet le premier historien à constater les responsabilités du commandement dans le désordre. Il dénonce la mauvaise organisation de l’armée pour la gestion des hommes et du matériel, la transmission des ordres… Pour le colonel Goutard l’origine de la défaite est avant tout à chercher dans une doctrine « périmée », un plan de campagne « erroné », un dispositif général « défectueux ». Tout au long de son ouvrage, il affirme que l’armée n’a pas fui, que la Wehrmacht pouvait être vaincue et que la responsabilité d’un haut commandement vieillissant est complète. « Notre défaite peut être imputée essentiellement à une carence intellectuelle qui se traduisait essentiellement par le conservatisme, le conformisme, les idées préconçues et les spéculations hors du réel, bref à une colossale erreur de commandement, rendue irrémédiable par le manque de ressort de l’époque, bien plus qu’à une impuissance foncière de notre Armée et du Pays dont elle émane. » Paul André Lesort a écrit « Quelques jours de juin 40, mémoire, témoignage, histoire » Il a combattu lui aussi en 40 et dénoncé une double trahison : Celle des chefs militaires et des politiques qui avaient mal préparé leurs soldats à la Blitzkrieg. Celle de la mémoire nationale où l’oubli se mêle au discrédit, alimentés par les erreurs et les déformations des livres d’histoire. Dans « Mai-juin 40, les combattants de l’honneur » Eric Lefèvre et les colonels Delmas et Devoutour soulignent que l’armée a fait force localement et de manière admirable à Stonne, Montcornet, Lille, Dunkerque, sur la ligne Maginot, dans les Alpes… Tous ces témoignages vont remettre en question la condamnation primaire des combattants de 40 et à partir de 1970, c’est une autre vision des choses qui se fait jour. IV - A partir de 1975 mai-juin 40 sous un nouveau jour Ce sont des historiens anglais, américains, allemands qui vont éclairer d’un jour nouveau cette tragique période. Un ouvrage clé « Mai-Juin 40, défaite française, victoire allemande sous l’œil des historiens étrangers » sous la direction de Maurice Vaïsse expose ces thèses nouvelles. Selon l’historien anglais Julien Jackson tant que de Gaulle était présent c’est la Résistance qui était mise en avant et la période 39-40 quelque peu oubliée. D’autre part, après 1975 les historiens ont eu accès aux archives ce qui changea bien des choses. Les historiens allemands ont fait eux ressortir la vulnérabilité de la Wehrmacht et les limites de la Blitzkrieg comme on a pu le constater en URSS. Une armée française trop méthodique C’est un des graves reproches fait à l’armée française de 1940. Le commandement français donne plus d’importance à l’obéissance et à la précision qu’à l’initiative et à l’imagination, faisant trop confiance à la logique et à la raison. Les Allemands pensent qu’il faut laisser l’initiative aux chefs des unités engagées sur le terrain. Guderian et Rommel ont désobéi aux ordres de leurs chefs en fonçant sur la Baie de Somme et ont ainsi assuré la victoire de l’Allemagne nazie. Le mythe de la guerre éclair Selon Karl H. Friser, la Blitzkrieg ne serait qu’une légende. Elle a été réussie mais a été improvisée. Il pense que l’armée nazie a frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Il relate « deux miracles » : La traversée des Ardennes par 41.000 véhicules allemands sans être bombardés. La débandade de la 79ème division d’artillerie à Bulson qui a laissé passer les blindés allemands. Les historiens allemands portent un jugement sur le haut commandement français. Ils reconnaissent une grande intelligence à Gamelin mais soulignent son incapacité à organiser, à agir, bref à commander ! Les chefs militaires français de l’époque étaient convaincus que la défensive est préférable à l’offensive car « le feu tue ». « L’étrange victoire » des Allemands s’explique ainsi. Les anglo-saxons s’intéressent à l’effort d’armement consenti pendant les années précédant la guerre. Il a certes été tardif du côté français mais très réel. De septembre à décembre 39, la France a produit 500 chars, l’Allemagne 247… Mais le facteur mental a joué un rôle prédominant. D’un côté une armée jeune et fanatisée, de l’autre un peuple pacifiste qui n’est pas encore remis de la saignée 14-18. V - La réhabilitation des combattants de 40 L’ouvrage de Dominique Lormier « Comme des lions – le sacrifice héroïque de l’armée française » paru en 2005 est essentiel.. « On a souvent écrit que les faibles unités françaises présentes s’étaient enfuies dès l’approche des troupes allemandes. Rien n’est plus faux » Il cite quelques faits d’arme : La victoire des chars alliés à Hannout en Belgique Les Batailles de Gembloux et Monthermé La destruction par 2 chars français de 100 blindés allemands, le 17 mai La bataille de Stonne (reprise 17 fois aux Allemands) L’attaque de la 4ème division cuirassée du colonel de Gaulle La bataille d’Abbeville le 29 mai Les combats héroïques autour de Dunkerque Dans les Alpes, 7 329 Allemands sont mis hors de combat contre 583 français 6 029 soldats italiens sont tués ou blessés contre 234 français L’auteur souligne le défaitisme du gouvernement. Le 17 juin, Pétain déclare « qu’il faut cesser le combat ». L’armistice ne sera signé que le 22. Pendant ces cinq jours les Allemands font 1 100 000 prisonniers, bien plus que depuis le début de l’offensive le 10 mai. L’armée française s’est battue, elle aurait continué à le faire si un gouvernement indigne ne l’avait livrée à l’ennemi. L’aviation française Elle fut souvent mise en cause. En fait, elle a surtout souffert des ordres donnés par la hiérarchie militaire qui la considérait comme une arme auxiliaire. A partir de 1980 elle est réhabilitée. Historiens, ingénieurs et militaires insistent sur les retards de la stratégie et la tactique de l’état major aérien et du haut commandement en général. De nombreux avions, les plus récents sont restés à l’arrière et n’ont pas été engagés dans les combats ! Les historiens étrangers n’ont pas compris l’écrasement de cette armée française, considérée jusque là comme la première du monde. Leurs conclusions diffèrent totalement de ce qu’on avait pu lire jusqu’ici. Une accumulation de malchance pour la France, un enchaînement d’heureux événements pour l’Allemagne « étrange défaite » d’un côté, « étrange victoire » de l’autre. Conclusion Cette période mai-juin 40 a signé la disparition de la France comme grande puissance. C’est donc une date clé, ce qui explique qu’un aussi grand nombre d’études lui ait été consacré. D’année en année des vérités apparaissent et des réhabilitations se sont imposées, au risque parfois d’aller un peu trop loin, comme la réhabilitation de Gamelin par des historiens anglais ! Bibliographie M. Bloch : L’étrange défaite – Gallimard J.B. Duroselle : La bourrasque – l’effondrement – Imprimerie Nationale Karl H.Frieser : Le mythe de la guerre éclair - Berlin Colonel A. Goutard : 1940, la guerre des occasions perdues – Hachette Eric Lefèvre, colonels Delmas et Devoutour : Mai –Juin 40, les combattants de l’honneur – Copernic Paris Paul André Lesort : Quelques jours de juin 40 – Seuil Dominique Lormier : Comme des lions – le sacrifice héroïque de l’armée française – Calmann Lévy M. Vaïsse : Mai-juin 1940 – défaite française, victoire allemande sous l’œil des historiens étrangers – Autrement Les
mémoires françaises de la Seconde Guerre mondiale
et leur évolution
Annales
corrigées
: composition Histoire-Géo
Les clés du sujet Entrer dans le sujet, définir les mots clés • Ce sujet complexe vous amène à dissocier les notions d’histoire et de mémoire. La mémoire se définit comme l’ensemble des formes que prend le passé dans la société ; elle se cristallise, d’après Pierre Nora, dans des « lieux » : monuments, commémorations d’événements, références symboliques… Elle ne découle pas d’une étude rigoureuse et problématisée des sources, comme l’histoire. Depuis 1945, des mémoires divergentes se sont construites, et leur diversité révèle le traumatisme des « années sombres » dans la société française : pour reprendre le mot de H. Rousso, le pays n’arrive pas à se réconcilier avec « un passé qui ne passe pas ». • Le terme « évolution » induit une mutation de ces mémoires dont on veut faire apparaître la chronologie et les enjeux : la lutte pour le pouvoir entre résistants communistes et gaullistes après la guerre, la stabilisation avec la thèse gaulliste de la France résistance et de la continuité républicaine, puis l’émiettement des mémoires dans les années 1970 ; réapparaissent alors des mémoires minoritaires, celles des victimes, enfin entendues, et celles des bourreaux, enfin jugés. Le cinéma et la recherche historique jouèrent alors un rôle majeur dans la diffusion à un large public de ces mémoires. Les années 1980 ouvrent une ère nouvelle, avec les procès des anciens responsables de Vichy (Touvier, Papon), l’émergence du négationnisme, mais aussi la reconnaissance progressive de la responsabilité de l’État français dans le génocide juif. • Même si la Seconde Guerre mondiale n’est pas au cœur du sujet, vous devez utiliser les notions de Résistance, collaboration, génocide… Dégager la problématique Comment se déroule la guerre des mémoires nées de la Seconde Guerre mondiale ? Comment est-on passé de l’amnésie, symbolisée par le mythe de la France résistante, à la repentance d’aujourd’hui ? Définir le plan I. La construction de mémoires rivales dans une France traumatisée et la victoire de la thèse du résistancialisme (1945-1969) II. Le retour des mémoires refoulées : émiettement et élargissement des mémoires du conflit (1969-début des années 1980) III. Le temps des repentances : des grands procès à la reconnaissance du rôle de l’État français (années 1980 à nos jours) Introduction [Accroche] « La marée, en se retirant, découvre […] le corps bouleversé de la France… » De Gaulle esquisse ainsi, dans ses Mémoires de guerre, le portrait d’une France désorientée, disloquée, prisonnière de son passé en 1945. [Définition du sujet] La mémoire et l’histoire sont proches et lointaines à la fois. Les deux jettent un pont entre passé et présent, mais, si la mémoire renvoie à l’ensemble des formes que prend le passé dans la société, l’histoire tente, elle, de comprendre le passé pour éclairer le présent. [Problématique] Comment se déroule la guerre des mémoires nées de la Seconde Guerre mondiale ? Comment est-on passé de l’amnésie, avec le mythe d’une France unie et résistante, à la repentance d’aujourd’hui ? [Annonce du plan] Après avoir étudié la construction de ces mémoires et leur effacement devant l’idée du résistancialisme, il faudra montrer comment les mémoires refoulées ont ressurgi après 1970. Pour terminer, nous suivrons le cheminement récent de l’État français vers un processus de repentance. I. Dès 1945, des mémoires rivales émergent dans une France traumatisée. Cette guerre des mémoires se clôt avec la victoire du résistancialisme 1. La mémoire de la guerre devient très tôt un enjeu stratégique dans la conquête du pouvoir entre gaullistes et communistes • Au sortir du conflit, une atmosphère de guerre civile règne en France : les maquis luttent pour récupérer le pouvoir local et l’épuration des « collaborateurs » devient incontrôlable : le spectacle des exécutions sommaires, des femmes tondues pour « collaboration horizontale », devient quotidien. Cette épuration sauvage fait 9 000 morts, auxquels s’ajoutent plus de 700 exécutions « légales ». • Le vide du pouvoir attise la convoitise des anciens résistants communistes et gaullistes, qui se livrent une guerre des mémoires pour s’imposer. Le PCF, premier parti de France, est crédité de 25 % des voix. Auréolé du prestige de l’Armée rouge, de sa participation à la libération du territoire, il prétend au pouvoir. Il ressuscite ses héros morts pour la France, (P. Vaillant-Couturier, G. Péri, G. Môquet) et se présente comme le « parti des 75 000 fusillés ». En réalité, les communistes n’ont résisté qu’après juin 1941 et le nombre des victimes n’excéda pas 30 000. Les gaullistes, quant à eux, construisent leur mémoire autour de la personne du général, de sa gestuelle (V de la victoire, uniforme militaire), de ses actes forts (appel du 18 juin 1940, défilé sur les Champs-Élysées après la libération de Paris). 2. De Gaulle, une fois au pouvoir, impose le souvenir de la France résistante et de la continuité républicaine ; ses successeurs conservent cette stratégie • Le général soumet les communistes et restaure tout d’abord l’autorité de l’État, prenant de vitesse les Américains. Il s’empare de l’administration, sans l’épurer car l’État a besoin de ses fonctionnaires et place des hommes sûrs (J. Chaban-Delmas). Il entend ainsi éviter la révolution et la guerre civile, en imposant l’idée d’une « parenthèse républicaine » : les Français auraient été les otages « de quelques malheureux traîtres ». Pourtant, la République est bien morte en 1940, et à peine 2 % des Français entrèrent en « résistance ». L’immense majorité s’est accommodée de l’Occupation. • La mémoire résistante s’organise alors : le cinéma lui offre des héros, comme dans La Bataille du rail de R. Clément (1946). Cette mémoire unitaire est frappée d’amnésie : elle tait la diversité des résistances (on pouvait avoir été maréchaliste et résistant, comme H. Frenay) et l’ambiguïté des situations. La stratégie unitaire est conservée sous la IVe République : les lois d’amnistie de 1951 et 1953 protègent les fonctionnaires vichystes. Le renvoi des ministres communistes le 5 mai 1947, après l’adhésion du PCF au Kominform, marginalise encore la mémoire communiste, alors que la décolonisation de l’Indochine et la guerre froide naissante imposent l’unité nationale. Le péril communiste consacre la victoire de la mémoire gaulliste. La présidence de de Gaulle apparaît comme l’apogée du résistancialisme. Revenu en 1958, il maintient sa lecture du conflit : le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon (1964) sacralise davantage la résistance héroïque. Révoqué par Vichy, rallié à de Gaulle, artisan de la jonction des résistances, mort sous la torture sans parler, il devient le martyr de la mémoire gaulliste. Aucune opinion contraire ne peut être formulée : en 1958, la censure s’abat sur Nuit et brouillard d’Alain Resnais qui doit retirer de son film la présence d’un gendarme aux ordres de Vichy… 3. Cette querelle ne saurait faire oublier l’existence d’une autre mémoire, revendicative, celle des pétainistes Elle s’organise dès 1945, incarnée dans la personne même de Pétain au moment de son procès. Son avocat, maître Isorni, défend la thèse du « bouclier » et du « double jeu » : Pétain se justifie en expliquant qu’il voulait servir de « paratonnerre » au pays. La collaboration aurait été un moyen de préserver la France jusqu’à ce que de Gaulle organise la résistance à l’extérieur. Condamné à mort, sa peine est commuée en prison à vie : une association de défense se crée, l’ADMP, servie par une maison d’édition (Nouvelles éditions latines) et une presse engagée (Rivarol). Elle organise des pèlerinages sur l’île d’Yeu où Pétain est détenu. En 1951, les candidats affiliés à cette mémoire rassemblent encore 10 % des voix. II. S’opère alors un retour des mémoires refoulées, de plus en plus nombreuses et émiettées, grâce au cinéma et au travail des historiens (1969-années 1980) 1. Tout d’abord, la télévision et le cinéma sensibilisent un plus large public à ces mémoires ; ils contribuent à leur prolifération • En 1971, Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophüls passe dans toutes les salles d’art et d’essai et démythifie l’unité de la France résistante ; la télévision refuse de le diffuser jusqu’en 1981, où il attire, sur FR3, 15 millions de téléspectateurs. Beaucoup découvrent alors le choix fait par certains Français de revêtir l’uniforme nazi. • Le choix entre résistance et collaboration n’allait donc pas de soi : d’autres films rappellent cette ambiguïté. Lacombe Lucien (L. Malle, 1974) raconte le destin tragique d’un jeune homme que le hasard fait milicien. Au revoir les enfants (L. Malle, 1987) relate le destin de jeunes enfants juifs chassés de l’école de la République. Uranus (C. Berri, 1990) critique les communistes à la Libération. Enfin, le Pétain de Marbœuf (1993) passe au crible tout le système de Vichy. Lanzmann, quant à lui, choisit le documentaire pour aborder ce thème, avec Shoah en 1967. D’autres préfèrent la dérision, pour pointer les failles de la Résistance, comme J. M. Poiré dans Papy fait de la résistance (1983). 2. Par ailleurs, les historiens portent un regard critique sur ces mémoires concurrentes et dénoncent leurs incohérences • En 1973, R. Paxton publie La France de Vichy et met l’accent sur le rôle primordial de Vichy dans la politique antisémite. Il révèle que l’État français est à l’origine de la collaboration avec l’Allemagne. À sa suite, de nombreuses vocations d’historiens vont naître (un tiers des thèses enregistrées en 1978). • En 1990, H. Rousso revient sur Le Syndrome de Vichy : il explique comment la France a été victime d’une sorte de refoulement de la mémoire, avant que celle-ci ne ressurgisse et ne vole en éclats vers 1970. Depuis, nous serions plongés dans une obsession de ce passé et de la repentance. 3. Dans ce contexte, on assiste au retour des mémoires refoulées, celles des victimes et celles des minorités • Le contexte a changé avec le personnel politique : le nouvel hôte de l’Élysée, G. Pompidou, écorne le mythe résistancialiste. Il veut mettre fin à l’époque « pendant laquelle les Français ne s’aimaient pas ». Cet engagement motive la grâce de Paul Touvier, ancien chef de la Milice, et provoque un scandale. • Deux types de mémoiresémergent alors : d’une part, celle des victimes, surtout celles du génocide juif. Sur les 75 000 déportés juifs français, moins de 3 % revinrent. Certains peinent à évoquer leurs souvenirs, mais d’autres ne sont pas entendus (Simone Veil). L’écriture constitue souvent un exutoire (Si c’est un homme, de Primo Levi, L’Espèce humaine de R. Antelme ou L’Écriture ou la Vie de J. Semprun). Cette mémoire peine néanmoins à s’autonomiser. Apparaît, d’autre part, une mémoire des minorités, oubliées en 1945 : les soldats n’ont bénéficié d’aucune héroïsation, sans doute dénigrés pour la débâcle de 1940 et ce, malgré leur sacrifice (100 000 morts en 45 jours) et leur détention dans les camps allemands. De même, les requis du STO peinent à obtenir le statut de « déportés du travail ». Les femmes tentent aussi de faire entendre leur voix, notamment les victimes des « tontes ». III. S’ouvre alors une dernière phase vers 1980 : vient le temps des scandales et des repentances, du négationnisme, des grands procès et surtout de la reconnaissance du rôle de l’État français dans la Shoah 1. En réaction à ces mémoires des victimes apparaît, dès la fin des années 1970, un courant négationniste rejetant le génocide • Au départ, ce courant est porté par des intellectuels d’extrême droite : le premier temps fort est l’interview de Darquier de Pellepoix, collaborationniste notoire, pour L’Express (1978), où l’ex-commissaire aux questions juives nie la « solution finale ». Un petit groupe d’historiens nie ensuite l’existence des chambres à gaz : R. Faurrisson évoque la « rumeur d’Auschwitz » pour qualifier le génocide. La réponse faite par les historiens à « cette secte minuscule mais acharnée » est virulente, comme celle de Pierre Vidal-Naquet dans Les Assassins de la mémoire. • Ces arguments sont relayés par l’extrême droite : le dirigeant du FN, J.-M. Le Pen, affirme en 1988 que les chambres à gaz sont « un détail de l’histoire » (propos réitérés en 2009 au Parlement européen) et que la Gestapo a eu un rôle « protecteur ». Il fut condamné et son exemple incita les hommes politiques à légiférer pour réprimer les propos négationnistes : la loi Gayssot, en 1990, en fait un délit. 2. Cette émergence coïncide avec l’ouverture d’une ère des procès : une mémoire des bourreaux fait alors à son tour surface • Prélude à la repentance, les procès des hauts fonctionnaires de Vichy dérivent rapidement vers un procès du système de Vichy. La justice et les victimes veulent à tout prix éviter une autre amnistie, après l’affaire Touvier. Tout commence avec le jugement du tortionnaire de J. Moulin, Klaus Barbie, capitaine SS et chef de la Gestapo lyonnaise, en 1987. Vient ensuite le tour de René Bousquet, qui avait mis les forces de police et de gendarmerie au service du Reich. Le plus retentissant reste néanmoins le procès de Maurice Papon, condamné en 1998 pour complicité de crime contre l’humanité. • L’historien acquiert, dans cette dernière affaire, une place nouvelle, car il est requis comme « expert » : certains acceptent de témoigner (Paxton), d’autres refusent (Rousso). Certains regrettent leur participation (Amouroux). 3. Les deux dernières décennies voient s’opérer une mutation décisive : l’entrée dans l’ère de la repentance et de l’obsession commémorative • La reconnaissance du rôle de l’État français est alors un leitmotiv : en 1993, une journée nationale commémore la mémoire de l’holocauste. En 1995, en mémoire de la rafle du Vel’ d’Hiv, J. Chirac reconnaît la responsabilité de la France dans le génocide juif. Son Premier ministre, L. Jospin, le confirme à la conférence de Stockholm (2000), tandis que, en 1997, J. Lang fait publier à 100 000 exemplaires un livre à destination des adolescents intitulé Dites-le à vos enfants ! L’Église de France se repent à son tour, en 1997. Enfin, en 2005 est inauguré un mémorial de la Shoah à Paris. • Cette période est aussi l’ère des révélations : l’amitié de F. Mitterrand pour R. Bousquet, puis les révélations du journaliste P. Péan sur le ralliement tardif de Mitterrand à la Résistance alimentent un certain malaise, d’autant que le Président continue à faire fleurir chaque 11 novembre la tombe de Pétain. Plus tard, le procès Papon jette le trouble et montre qu’un haut fonctionnaire vichyste pouvait encore être préfet de police pendant la guerre d’Algérie ou ministre sous Raymond Barre… La guerre des mémoires éclabousse de Gaulle et Giscard d’Estaing. Conclusion [Réponse à la problématique]« La France a encore mal à sa Deuxième Guerre mondiale », écrit R. Franck. La construction mémorielle a d’abord été le produit d’une lutte de pouvoir dans un pays disloqué par la collaboration d’État. Une amnésie volontaire occulte le rôle trouble de l’État français pour assurer la continuité républicaine. Dès 1970, ces mémoires refoulées ressurgissent, sous l’effet conjugué du travail historique et du cinéma : les masses découvrent les ambiguïtés des « années sombres ». L’État entre alors dans l’ère de la repentance, l’autocritique et l’obsession commémorative. [Élargissement] Cette volonté dénote un changement de cap : la France cesse de reporter la faute sur l’Allemagne, devenue son alliée à l’heure de la construction européenne. L’inflation mémorielle présente néanmoins des dangers, car l’excès de commémorations peut conduire à la banalisation. Le tollé provoqué par la volonté présidentielle de lire la lettre de Guy Môquet dans les écoles montre finalement que la guerre des mémoires n’est pas terminée. Le 18 juin, célébré depuis 1941 et institutionnalisé en 2006, « Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi » doit naturellement entretenir la mémoire des premiers héros de la résistance française : les solats français qui combattent en mai-juin 1940 « à l’avant-garde de la liberté », selon le mot même du général de Gaulle. D'autant que l'époque actuelle est plus au regroupement qu'à la multiplication des commémorations. Histoire et
mémoire
Simone MANON - PhiloLog - http://www.philolog.fr « A priori, histoire et mémoire sont deux perceptions du passé nettement différenciées. Le fait a été souvent analysé, en particulier récemment par Pierre Nora. La mémoire est un vécu, en perpétuelle évolution, tandis que l’histoire — celle des historiens — est une reconstruction savante et abstraite, plus encline à délimiter un savoir constitutif et durable. La mémoire est plurielle en ce sens qu’elle émane des groupes sociaux, partis, Eglises, communautés régionales, linguistiques ou autres. De ce point de vue, la mémoire dite «collective » est à première vue une chimère, car somme imparfaite de mémoires éclatées et hétérogènes. L’histoire en revanche a une vocation plus universelle, sinon plus oecuménique. Malgré les conflits, elle est une propédeutique de la citoyenneté. La mémoire, parfois, est du registre du sacré, de la foi; l’histoire est critique et laïque. La première est sujette au refoulement, tandis que, toujours a priori, rien n’est étranger au territoire de l’historien. Cette distinction est pourtant un trait propre au XX° siècle, mis en évidence par Maurice Halbwachs, disciple de Bergson, et qu’illustre l’évolution de l’historiographie contemporaine, tournée vers le savoir et non plus vers la légitimation. Au siècle dernier, en particulier en France, la différence n’existait pratiquement pas. L’histoire avait pour fonction essentielle de légitimer la République naissante et de forger un sentiment national ce que Pierre Nora appelle « l’histoire-mémoire ». Or, aujourd’hui, l’assimilation n’est plus possible l’éclatement de la société rurale porteuse de traditions ancestrales, l’inflation des sources d’information, qui ont entraîné une multitude d’approches de la réalité sociale, l’affaiblissement du sentiment national en Europe occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale, la profondeur des fractures internes, dont précisément celle de Vichy, ont fait diverger l’évolution de l’histoire et celle des mémoires : « Avec l’avènement de la société en lieu et place de la nation, la légitimation par le passé, donc par l’histoire, a cédé le pas à la légitimation par l’avenir. Le passé, on ne pouvait que le connaître et le vénérer, et la nation, la servir; l’avenir, il faut le préparer. Les trois termes ont repris leur autonomie. La nation n’est plus un combat, mais un donné; l’histoire est devenue une science sociale; et la mémoire un phénomène purement privé. La nation-mémoire aura été la dernière incarnation de l’histoire- mémoire » Pierre Nora, Les lieux de mémoire [1], tome I, p. XXV. D’où un nouvel atelier d’historien l’histoire de la mémoire, c’est-à-dire l’étude de l’évolution des différentes pratiques sociales, de leur forme et de leur contenu, ayant pour objet ou pour effet, explicitement ou non, la représentation du passé et l’entretien de son souvenir, soit au sein d’un groupe donné, soit au sein de la société tout entière. » Henry Rousso. Le syndrome de Vichy, de 1944 à nos jours [2], Seuil, 1987, p.10.11. Thème : l’histoire et la mémoire. Questions : Si dans sa forme traditionnelle l’histoire a d’abord été une « histoire-mémoire » destinée à cimenter un corps social, à forger un sentiment national et à légitimer l’ordre existant, qu’en est-il avec l’avènement d’une histoire soucieuse de se constituer selon une norme d’objectivité ? L’histoire et la mémoire ne sont-elles pas conduites à divorcer, d’autant plus qu’en lieu et place de la nation, il faut désormais parler de société, ensemble hétérogène de personnes ayant des passés différents et donc des mémoires différenciées voire conflictuelles? Thèse : La mémoire soit individuelle soit collective est la fonction du souvenir. Elle est la faculté de rappeler dans le présent quelque chose qui est identifié comme renvoyant au passé. En tant qu’elle est rétention dans le présent d’une chose passée, elle est un phénomène présent. Ce qui demeure ou est rappelé du passé n’est pas le passé lui-même, c’est sa trace présente. Il se peut donc qu’elle nous parle davantage du présent que du passé dont elle se veut la gardienne. « D’où un nouvel atelier d’historien : l’histoire de la mémoire, c’est-à-dire l’étude de l’évolution des différentes pratiques sociales, de leur forme et de leur contenu, ayant pour objet ou pour effet, explicitement ou non, la représentation du passé et l’entretien de son souvenir, soit au sein d’un groupe donné, soit au sein de la société tout entière. » Question : En quoi consiste l’hétérogénéité de l’histoire et de la mémoire ? Thèse : L’analyse comparative de l’histoire et de la mémoire permet d’établir les distinctions suivantes :
Autour de ce Sujet :
Article printed from PhiloLog: http://www.philolog.fr URL to article: http://www.philolog.fr/histoire-et-memoire/ 18 juin
« Journée nationale commémorative de
l'appel historique du général de Gaulle
à refuser la défaite et à poursuivre
le combat contre l'ennemi »
L'Appel du 18 juin 1940 est commémoré chaque année par les Français libres et les associations de Résistance qui vont se recueillir devant les monuments aux morts et les mémoriaux érigés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la mémoire des martyrs de la Résistance, au Mont Valérien à Suresnes et dans la plupart des villes françaises. Il est généralement d'usage à cette occasion 1° d'oublier le contexte historique immédiat et le sens premier de cet appel historique pour n'en garder que l'acte fondateur de la France Libre, 2° de ne pas mentionner les près de 100 000 soldats français tombés en mai-juin 1940 au cours de la campagne de France. On sait aujourd'hui, grâce aux historiens, François Delpa notamment, que « le discours du 18 juin est un objet historique des plus complexes ». En clair, ce n'est qu'au terme de longues tractations avec les anglais et après avoir dû amender son texte à plusieurs reprises que de Gaulle est autorisé à parler à la BBC. Face à Pétain, prestigieux vainqueur de Verdun, chef du gouvernement d'un pays allié, qui veut cesser le combat et solliciter un armistice, la demande d'un officier français peu connu à appeler les militaires français à désobéir, embarrasse le gouvernement britannique lui-même divisé quant à l'attitude à adopter sur la poursuite de la guerre. Appelé le 6 juin par Paul Reynaud avec pour mission « de s'inquiéter de tous les moyens existants de par le monde pour continuer le combat » et donc notamment préparer un repli sur l'Afrique du Nord, de Gaulle gagne une nouvelle fois Londres le 16 juin, au moment de la nomination de Pétain, qu'il sait opposé depuis des semaines à la poursuite des combats. Il tente tout d'abord convaincre les anglais de faire pression sur le nouveau gouvernement français puis, lorsque la demande unilatérale d'armistice est lancée sur les ondes le 17, il veut d’emblée proclamer que Pétain est déshonoré et qu’aucun Français ne doit lui obéir. Une esquisse de l’appel, datée du 17 juin, l’établit. Ainsi, les paroles qu'il voulait prononcer dès le 17 juin, il ne réussira à les émettre dans leur intégralité qu'au début de juillet ... une fois l'armistice signé. Pourtant, entre l’annonce prématurée de l’armistice le 17 juin et son entrée en vigueur effective le 25 juin, et parfois même au delà, l'armée française continue partout de se battre avec discipline et détermination. A l'est derrière la ligne Maginot, dans les Alpes, mais aussi au centre, où les soldats s'étant battu sur la ligne Weygand se replient en ordre marchant la nuit combattant le jour. (v. notamment Gilles Ragache - La fin de la campagne de France. Les combats oubliés des Armées du Centre, 15 juin - 25 juin 1940. Aux côtés de Bruno Chaix et de Max Schiavon, Gilles Ragache apparaît comme un des meilleurs spécialistes de cette page d’une histoire militaire méconnue). Les pertes en hommes et en matériels des deux côtés attestent de cette détermination. Les soldats français de juin ne sont pas simplement les derniers et courageux combattants d'une bataille perdue d'avance mais bien les premiers résistants d'une guerre mondiale qui s'engageait. Précurseurs de la Résistance armée, à défaut d'avoir pour beaucoup entendu ou lu les appels du général de Gaulle, ils en ont non seulement suivi sans le savoir mais surtout inspiré le message en refusant début juin 1940 la défaite annoncée et en poursuivant le combat jusqu'au bout. Pour autant, les deux sauveurs de 1940 s'attacheront, l'un à leur imputer la défaite, l'autre à faire oublier qu'il existait avant le 18 juin 1940 des résistants à l'envahisseur allemand. Mais, alors même que dans la vision gaullienne la guerre doit continuer, elle n'est pas continue, il doit y avoir un avant et un après le 18 juin, des moutons avant des héros après. La défaite n'est pourtant pas le bon critère car il y en aura d'autres après juin 40 sans que la guerre soit perdue. Parle-t-on de la déroute de tel réseau décimé, de la défaite du Vercors ? On ne regarde alors que la victoire finale.
 Saumur (sculpteur Pierre Duroux) haut-relief du Mont-Valérien, 1960. Le soldat qui tombe, frappé au coeur, symbolise le combattant de 1940 qui, comme à Saumur du 19 au 21 juin, mène un combat inégal mais se bat jusqu'au sacrifice suprême. L'appel du Général ... Besson La
Loire n'était pas en juin 1940 un obstacle symbolique. La
participation héroïque des Elèves
Aspirants de Réserve (EAR) de la Cavalerie et du Train de l'école
militaire de Saumur à
la défense sur la Loire ne doit pas faire oublier
l'important et
efficace dispositif regroupé sur le fleuve le plus long de
France. Les "Cadets" de Saumur furent salués par les
allemands
comme pour signifier que le reste de l'armée
française n'avait pas
combattu, là comme ailleurs, ce que beaucoup croient encore
de nombreuses
années plus tard !
La 87e DIA, dont fait partie le 18e RTA, franchit la Loire à Gien - à 250 km de Saumur - le 17 juin. Sur un front de 400 km s'engage la bataille pour le contrôle de la Loire. Au centre du dispositif français, le régiment prend part à la défense en profondeur du secteur autour de Gien où se livre tout au long de la journée du 18 juin une bataille acharnée au milieu des civils qui cherchent à traverser le fleuve. Les tentatives allemandes sont toutes repoussées par des soldats français n'ayant pas renoncé à combattre. Au soir du 17 juin, le Gal Besson Commandant le Groupe d'Armée n°3, avait pris soins de dissiper les effets calamiteux du discours du nouveau Président du Conseil appelant à cesser le combat : " Il n'y a ni armistice, ni suspension des d'armes. La bataille continue. " ... Pétain
n’est pas un brave type
Le
17 mai 1940, une semaine après le début de
l'offensive
allemande, Pétain est nommé
vice-président du conseil dans le gouvernement de Paul
Reynaud, pour qui il
s'agit
de remonter le moral du pays. Reynaud sous-estime le vieillard
au
début taciturne et passif. Il n'imagine pas qu'il
puisse
jouer plus qu'un rôle purement symbolique.
Non seulement le sursaut espéré ne se
produit pas
mais le pessimisme légendaire de Pétain tourne au
défaitisme dont il devient le chef de file au sein
du gouvernement. Le vocabulaire
bienveillant " vainqueur de Verdun " ou neutre "
régime de vichy "
inventé en 40 est tombé aujourd'hui en
désuétude. Ses adversaires, à qui
l'histoire donne raison utilisent les termes : père la
défaite
et dictature de
Petain. Le point de vue des historiens américains anglais
allemands
est particulièrement intéressant sur ce
sujet.
La révolution des ratés Bernanos parle avec lucidité de « triomphe d'une minorité impopulaire qui, depuis vingt ans, cherchait en vain sa chance et qui l'a trouvée enfin dans le désastre national » menée par un « vieux traître » et sa « révolution des ratés ». La Ligne Weygand Dès le 25 mai, Weygand renonce à son plan initial de dégagement des armées du nord encerclées et envisage une nouvelle manoeuvre : fixer le plus logtemps possible au nord le gros des forces ennemies pour gagner le temps d'établir au sud un front défensif échelonné en profondeur de l'embouchure de la Somme à la ligne Maginot passant Abbeville, Amiens, Laon et Rethel, où les forces françaises attendront ! la deuxième phase de la bataille. En fin de journée, il expose au Comité de guerre réuni à l'Elysée la situation sur le front sud où nos troupes tiennent une ligne comprenant la Ligne Maginot, les fortifications qui suivent jusqu'à Montmédy, l'Aisne, l'Ailette, le canal Crozat, et la Somme jusqu'à la mer. Cette nouvelle ligne de défense d'environ 280 kilomètres de long est en voie de formation et nous y disposerons de 59 divisions, face 130 à 150 divisions allemandes, dont 9 division blindées, selon Weygand. Nous n'aurions pas non plus les réserves voulues pour opérer en bon ordre, sous la pression ennemie, une retraite méthodique de la ligne Somme-Aisne vers la ligne Basse-Seine-Marne. Il ne reste donc pour Weygand qu'une solution : tenir la position Somme et nous y défendre jusqu'à la dernière extrémité même si cette position présente de nombreux points faibles, en particulier le canal Crozat et l'Ailette ... Le front pourra y être percé mais même dépassées les troupes poursuivront la résistance sur place : " l'armée devra se battre jusqu'à épuisement pour sauver l'honneur du pays." Les 1e, 7e et 9e armées éliminées, les généraux Prioux, Billotte, Giraud morts ou prisonniers, les trois D.L.M.et les trois quarts des D.C.R. détruites... début juin, à l'issue de trois semaines de combats, l'armée française a perdu le tiers de ses forces, les trois quarts de ses moyens mobiles. L'ennemi aligne 120 divisions, dont dix blindées, contre 60 françaises. Les Italiens menacent sur les Alpes. Que peut faire Weygand ? Il choisit de tout miser sur une seule bataille "frontale". Ses unités ont ordre de tenir sans esprit de recul derrière la ligne Maginot, l'Aisne, l'Ailette et la Somme. Mais le risque est énorme. Si - comme il est probable - , cette ligne vient à céder, tout le territoire sera envahi en quelques jours. On a bien sur reproché ce choix à Weygand. Que pouvait-il faire d'autre ? Un lent recul en combattant est difficile pour une armée à pied face à un adversaire qu'il imagine motorisé. Cette retraite échelonnée aurait un énorme avantage : donner le temps de faire passer des machines, des spécialistes, les troupes, en Afrique du Nord, pour continuer la lutte. Mais Paul Reynaud, comme tous les Français, veut croire à un second "miracle de la Marne", d'autant que tous les rapports lui signalent un moral élevé dans la troupe. Sans pour sa part renoncer au repli, il accepte une grande bataille sur la "ligne Weygand" et diffère la décision. Et, sous le soleil de juin, les soldats français vont prouver qu'ils savent, comme leurs aînés de 14, se battre "comme des chiens", selon la formule de Weygand. D'après 39-40 La campagne de
France, Jean Lopez
Ultime combat ou
bataille de retardement
La
question est ouverte depuis le 25 mai lorsque Weygand renonçant à
toute nouvelle
manoeuvre présente son projet
d'ultime bataille
défensive sur la Somme et l'Aisne. Divers propositions
de bataille de
retardement en vue d'un embarquement des
forces encore sur pied vers l'Afrique du Nord et l'Angleterre voient le
jour, dont celle des généraux
Besson, du Groupe
d'Armées n°3, et Frère, de la
7e Armée.
Il semblerait que la question se soit posée au sein du 18e RTA. Si en effet les Ier et IIIe bataillons furent anéantis sur place devant St-Paul-aux-Bois et Manicamp, devant Besmé le IIe Bataillon pu faire mouvement et se replier non sans avoir combattu. Il est vrai que ses positions avancées se trouvaient dans les bois de Manicamp et de Fève, que les alleamnds coutournèrent. Dans l'attente de confirmation des archives, un élément permet d'étayer cette hypothèse : le commandant Haack à la tête du IIe bataillon début juin prend le commandement de ce qui reste du régiment le 18 juin à Grand-Val. Il est peut probable qu'on ait placé là au moment du repli un chef qui n'aurait pas été méritant sur l'Ailette et en désaccord avec le général Martin qui opéra à la tête de la 8e DIA un repli exemplaire commandé par les généraux Besson, du Groupe d'Armées n°3, et Frère, de la 7e Armée.. L'Ailette, entre
Somme et Aisne sur la route de Paris
Entre
Aisne et Somme on trouve du sud au nord :
- le Canal de l’Aisne à l’Oise (ou Canal de l’Ailette, dont il suit le cours) dans sa totalité reliant l’Aisne (à Bourg-et-Comin) à l’Oise (à Manicamp-Abbécourt), soit 48 km en passant sous le Chemin des Dames ! Il est tenu toujours du sud au nord par la 28e DI, la 7e DI, avec loin en arrière la 8e DI, la 87e DIA avec loin en arrière la 11e DI (derrière l'Aisne comme la 8e DI). - le Canal latéral à l’Oise (dont il suit le cours) en partie de Manicamp-Abbécourt à Tergnier, soit 12 km environ, tenu par la 23e DI en partie. - le Canal Crozat ou Canal de St-Quentin en partie reliant l'Oise (à Tergnier) à la Somme et son canal (à Saint-Simon), soit 15 km environ tenu par la 23e DI en partie, la 3e DLI avec loin en arrière la 7e DIC vers Compiègne. On se trouve de Bourg-et-Comin à Saint-Simon dans le Département de l’Aisne. Mercredi 5 juin 1940, la campagne de France entre dans sa deuxième phase. L'armée française a perdu une vingtaine de divisions (un tiers de ses forces initiales) sur la Meuse et dans les Flandres (ses meilleurs unités ainsi que leurs blindés), l’armée britannique a rembarqué. Aussitôt après la chute de Dunkerque le 4, Hitler retourne l'essentiel de ses forces vers le sud. Weygand, qui a remplacé Gamelin à la tête des armées françaises tente de rassembler une quarantaine de divisions d'infanterie et trois divisions blindées en cours de formation pour défendre un front improvisé en moins de deux semaines, étiré d’Abbeville à la Ligne Maginot : sur la Somme, l'Ailette et l'Aisne. En face, 120 divisions allemandes dont 10 PanzerDivisions avec plus de 2.000 chars. De Gaulle a préconisé de rassembler les 1.200 chars qui existent encore ... Face aux 3.000 avions de la Luftwaffe, l'Armée de l'Air est réduite à 1.000 appareils. Sur terre comme dans les airs, le rapport de force est désormais de trois contre un sans compter les réserves allemandes. La France n'en a plus. Les unités françaises jetées dans la bataille au gré des événements, défendent désormais seules et sans moyens modernes la liberté du monde. Elles ont pour consigne de résister sur place ... jusqu'à l'arrivée des armées rescapées du Nord qui débarquent à Cherbourg ... La « Ligne Weygand » regroupe au 5 juin 1940, à gauche la Xe Armée du Gal Altmayer sur la Somme de la Manche à l'est d'Amiens. Au centre, la VIIe Armée du Gal Frère, sur la Somme, le Canal Crozat et l'Ailette de l'Oise à Coucy-le-Château, dont la 87e DIA constitue l'aile droite face à la jonction des VIe et IXe armées allemandes. A droite, sur l'Aillete puis l'Aisne jusqu'à Neufchâtel-sur-Aisne la VIe Armée du Gal Touchon. Ces trois armées forment le Groupe d'Armées n°3 (GA3) du Gal Besson. A sa droite, de l'Aisne à la Ligne Maginot, les IVe Armée du Gal Réquin et IIe Armée du Gal Faeydenberg forment le GA4 du Gal Huntziger. 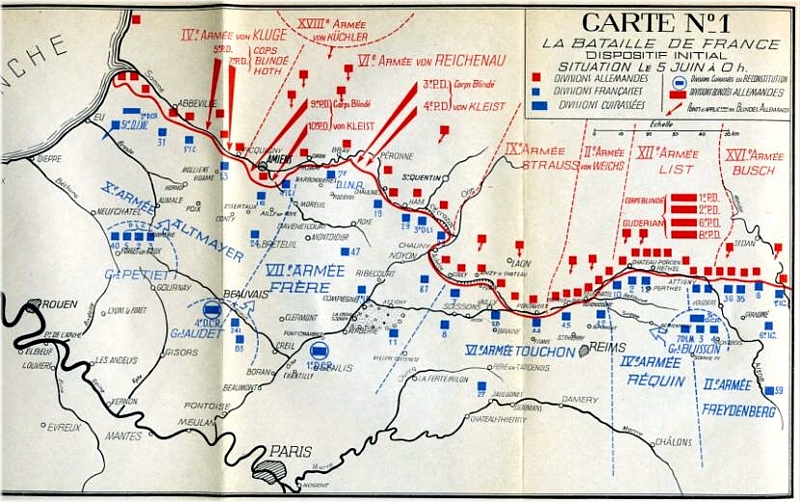 Carte extraite de « Soixante jours qui ébranlèrent l’occident » de Jacques Benoist-Méchin.
Les meilleures troupes allemandes fortement appuyées par de l'aviation et des blindés s'élancent le 5 juin à l'assaut des positions françaises improvisées en moins de deux semaines, mais décidées à tenir. Hitler va chercher à rompre d'abord les lignes françaises sur la Somme (von Bock), moins faciles à défendre, puis sur l'Aisne (von Rundstedt) avant de lancer une offensive générale prenant à revers le dispositif plus solide de la Ligne Maginot. La résistance est acharnée sur l'ensemble du front. Au sud d'Amiens, le 14e PanzerKorps est bloquée pendant cinq jours par les 16e et 24e DI françaises qui se battent « comme des lions » de l'aveu même des allemands. Le 14e PzK a perdu 235 chars, plus de la moitié de ses chars et 40 % de son infanterie 27.000 tués ou blessés. La 7e PanzerDivision de Rommel est repoussée une semaine sur la Somme dans le secteur de la 5e DIC. La 87e DIA sur l'Ailette ... Sur l'Aisne, la résistance héroïque à Stonne a permis de constituer un front cohérent de Châteu-Porcien à Stenay où la 14e DI du Gal de Lattre tient en échec les 9 et 10 juin le XXIIIe Korps allemand. Le massacre de Clamecy et la mémoire sélective L'évènement
est généralement connu comme "Massacre
de 43 tirailleurs sénégalais à
Clamecy" mais le monument qui commémore le
massacre de 43 tirailleurs par les allemands le 18
juin 1940 concernen bien parmi les 32 tirailleurs
identifiés, 11
Algériens, 6 Guinéens, 5 Ivoiriens, 4 Marocains,
2 Soudanais (Mali), 2 Voltaïques (Burkina Faso) et 2
Sénégalais.
Le monument, un jeune soldat noir qui semble se retenir à une sorte de totem africain a été inauguré le 20 juin 1948 sur le lieu de l'exécution. Il est situé à la sortie de la ville, sur la gauche de la D 144 en direction de La Charité et Varzy. Par la suite, un documentaire, "Les 43 Tirailleurs" de Mireille Hannon, rend hommage aux soldats tués par la haine raciste et remet en lumière l'évènement perdu dans la mémoire collective. Le 18 juin 1940, les allemands qui avaient capturé et disséminé les soldats français dans trois camps à Clamecy, entraînent 44 soldats « français africains » vers le petit bois de la Pépinière. Ils les abattent sans raison, imbibés par la propagande nazie. Parmi les 32 tirailleurs identifiés, on compte toujours 11 Algériens, ... Pourtant, la réalisatrice a "choisi de suivre la piste du Sénégal, car ce pays a déjà fait un travail de mémoire considérable. En revanche, si j'avais opté pour retrouver les familles des Algériens, le poids de la Guerre d'Algérie eut été trop lourd pour raconter ces soldats venus se battre en 1940 pour défendre la patrie du colonisateur." Assimilation : la fin du modèle français Directrice
de recherches à l'INED (Institut National des Etudes
Démographiques), Michèle Tribalat
étudie depuis de nombreuses années les questions
liées à l'immigration et à l'Islam.
Elle publie "Assimilation : la fin du modèle
français" aux éditions du Toucan
L'assimilation est un processus social de convergence des comportements, auquel la mixité des unions apporte une contribution décisive. C'est ainsi que des millions d'immigrés et d'enfants d'immigrés sont devenus des Français à part entière depuis des générations. Or, avec l'arrivée de nouvelles vagues migratoires de personnes d'origines musulmanes, ce modèle a cessé de fonctionner. Cette intégration s'effectuait dans un rapport inégalitaire entre la nation qui accueille et les nouveaux venus. Italiens, Espagnols, Portugais et Polonais au XIXe et au XXe siècle, ce sont eux qui ont fourni l'essentiel de l'effort d'intégration, sous la pression sociale exercée par la population autochtone. Pour des raisons politiques et idéologiques, du fait de mauvaises consciences et d'un passé mal assumé, la France d'abord puis l'Europe ont brisé ce modèle. En république, l'assimilation nécessite que le corps social s'engage sans réticence - en l'occurrence les classes populaires qui sont au front de la cohabitation inter-ethnique - et dans son entier, élites comprises. Ce n'est plus le cas. C'est l'un des tabous les mieux enfouis politiquement. Les autres livres de Michèle Tribalat : "La République et l'Islam" (Gallimard, 2002), "Les Yeux grands fermés" (Denoël, 2010) France Info, 2 octobre 2013
Dounia Bouzar et les dérives sectaires de l'islam radical Dounia
Bouzar est une anthropologue du fait religieux, membre de
l'Observatoire national de la
laïcité. "Désamorcer l'islam
radical",
c'est le titre de son dernier livre. Un islam radical dont
elle
dénonce les dérives sectaires.
"L'islam radical", pour Dounia Bouzar, c'est lorsque "le discours religieux mène des jeunes à l'auto exclusion et à l'exclusion des autres", lorsqu'il les mène à la rupture avec la société, avec leurs amis, avec leurs anciennes activités, avec leur famille. L'anthropologue affirme que ce phénomène se développe : "Il y a quelques années ce discours ne touchait que des jeunes sans pères et sans repères". Pour elle, il s'agit de comportements "sectaires" : "C'est une maman qui voit son fils arracher un rideau parce que des chameaux y sont dessinés et qu'il y voit le diable, ce sont des jeunes qui vont soudain transformer la religion en code qui se voit, qui s'exhibe. Ils ont l'impression d'être élus dans un groupe purifié". Une barbe ou le niqab sont des signes évidents. D'autres le sont moins. "L'amalgame profite aux radicaux" Parfois, ces tendances radicales apparaissent dans les entreprises. Par exemple, lorsque un homme "radicalisé" refuse soudain de serrer la main des femmes qui l'entourent. Pour Dounia Bouzar, cela est inacceptable. La chercheuse estime que les entreprises ne doivent pas le tolérer : "Est-ce qu'on l'accepterait d'un chrétien ? Est-ce qu'on accepterait qu'un salarié refuse de serrer la main de quelqu'un parce qu'il est de couleur ou parce qu'il est musulman ? C'est la même loi (...) Il ne faut surtout pas se dire c'est normal et ne rien faire. Le laxisme profite autant aux radicaux que la discrimination". Dounia Bouzar insiste sur les risques d'amalgame entre radicaux et simples croyants musulmans : "L'amalgame profite aux radicaux. Elle les valide comme des religieux. Il faut au contraire leur enlever leur justification". Le livre de Dounia Bouzar - "Désamorcer l'islam radical" est publié aux éditions de l'Atelier. |
|||||||||||||||||||

Retour Quierzy 1939-1945 | Expo 40
